Manger, vibrer...
Certes la qualité d’un produit dépend de nombreux facteurs dits « physiques ». Les valeurs nutritionnelles et gustatives d’un légume varient selon son terroir, sa saison, son mode cultural, sa maturité, sa fraîcheur, sa qualité de conservation et de préparation. Mais ce serait trop vite oublier nos représentations, nos perceptions et notre niveau de conscience qui jouent un rôle déterminant dans ce que nous mangeons.
François Besancenot - paru dans le magazine Bon
10/23/20242 min read
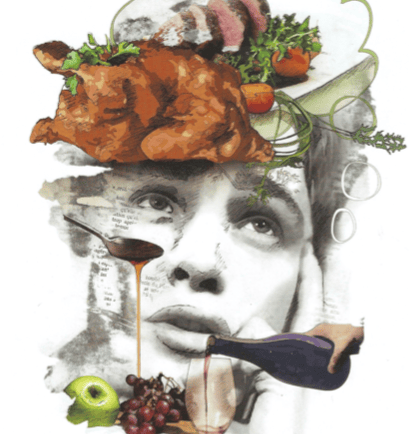

Nos représentations viennent de nos pensées. Elles font intervenir la connaissance que l’on a du produit et la manière de l’appréhender mentalement. La beauté d’un vignoble, le prestige d’un domaine, le discours du vigneron améliorent, c’est bien connu, le goût d’un vin. Selon le sociologue Jean-Pierre Poulain, le produit devient d’ailleurs aliment dès l’instant qu’il est « l’objet de projections de sens de la part du mangeur. Il doit pouvoir devenir signifiant, s’inscrire dans un réseau de communications, dans une constellation imaginaire, dans une vision du monde.» Une nourriture est dès lors « bonne à manger » et « bonne à penser », pour reprendre l’expression célèbre de l’ethnologue Claude Lévi-Strauss.
Nos perceptions relèvent de nos sentiments et de nos sensations. Le géographe Jean-Robert Pitte évoque ce qui concourt, à l’occasion d’un repas très raffiné, « à créer une atmosphère dont l’harmonie, reconnue par les convives et partagée par la conversation, est le signe d’un moment intense.». On y retrouve : « la beauté des formes et des couleurs (des mets comme de la table et du décor), les fumets, le bruit des liquides précieux qui s’écoulent, des pâtes feuilletées et des grillades qui croustillent, le toucher de cristaux, des argenteries et des fines lingeries de table, les consistances glissantes, résistantes ou craquantes des mets (…) ».
Notre conscience participe de la fusion des deux, représentations et perceptions. C’est ce qui arrive lorsqu’on déguste un produit depuis son contexte d’origine : « le sandwich au hareng saur dévoré à belles dents et arrosé d’aligoté dans le petit matin frais des vendanges bourguignonnes, le marron grillé du coin des rues de Paris les jours de brouillard glacé, les moules-frites dégustées sur les grandes plages d’Ostende et de Knokke-le-Zoute (…) » (Pitte, 2005).
Si nos représentations, nos perceptions et notre conscience s’activent de manière positive, alors manger aura un effet anti-stress, « placebo » voire stimulant. Libérant la dopamine, molécule du plaisir et de la récompense mais aussi l’endorphine, qui lutte contre l’anxiété et le stress, le cerveau favorisera la relaxation, la pleine disponibilité des organes à participer à la digestion (contraction des muscles intestinaux optimisée, transit facilité) et donc une meilleure assimilation des nutriments. Ne négligeons pas non plus la dimension vibratoire, chère à la physique quantique. Nos organes qui sont formés de tissus qui eux-mêmes sont composés de molécules qui elles-mêmes sont constituées d’atomes qui communiquent entre eux par vibrations, deviennent réceptifs aux vibrations que lui envoie le cerveau. Plus nos intentions sont bonnes, plus nos vibrations sont harmonieuses et plus nos organes assurent au mieux leur fonction.
Faut-il dès lors préférer nos chips industrielles favorites aromatisées au poulet rôti dans une ambiance joyeuse plutôt qu’une barquette de carottes râpées bio, à l’huile de noix et aux graines de chia bio dégustée sans conviction ? Je vous laisse juge. Mais attention, esprit et produit vont de pair. Bien manger c’est à la fois bien connaître, bien choisir, bien conserver, bien cuisiner un produit mais c’est aussi vibrer pour lui !
Ouvrages cités :
Pitte Jean-Robert, 2005, Gastronomie française. Histoire et géographie d'une passion, Paris, Fayard
Poulain Jean-Pierre, 2013, Sociologies de l'alimentation. Les mangeurs et l'espace social alimentaire, Paris, PUF,
Lévi-Strauss Claude, 1962, Le Totémisme aujourd’hui, Paris, PU
